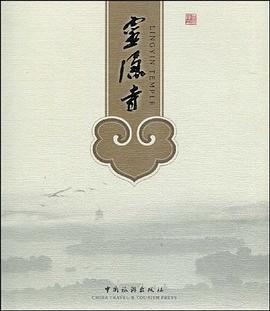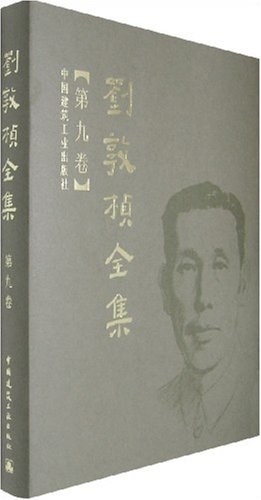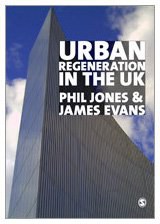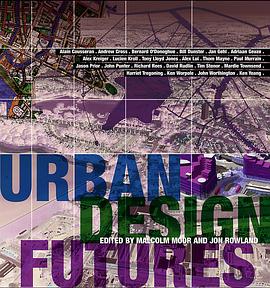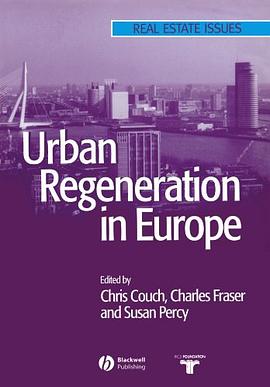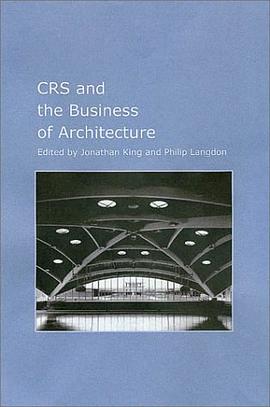Temples et monastères de Mongolie-Intérieure 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

簡體網頁||繁體網頁
Temples et monastères de Mongolie-Intérieure pdf epub mobi 著者簡介
Isabelle Charleux, Ph.D., is senior researcher at the National Centre for Scientific Research, France. She authored books, scholarly articles and catalogues on Mongol material culture, including Temples et monastères de Mongolie-Intérieure (Paris, 2006) and is director of the publication "Nord-Asie."
Temples et monastères de Mongolie-Intérieure pdf epub mobi 圖書描述
La culture mongole du XVIe à aujourd’hui siècle ne peut se comprendre sans le bouddhisme de rite tibétain, qui guidait étroitement la littérature et les arts, la vie intellectuelle ainsi que les conceptions morales et scientifiques (astrologie et mathématiques tibétaines). Bien que le bouddhisme ne soit pas parvenu à unir les tribus déchirées par les querelles intestines héritées de la période impériale, sa rapide propagation à la fin du XVIe siècle et sa promotion par les Mandchous en ont fait un des principaux facteurs d’unité culturelle, dépassant les frontières tribales pour lier tous les Mongols dans une foi commune. De plus, partout où il s’est implanté en Asie, le bouddhisme a totalement renouvelé les conceptions et la pratique de l’architecture et de l’art monumental, en particulier chez les peuples nomades comme les Mongols et leurs prédécesseurs. Or les études sur le bouddhisme mongol se sont jusqu’ici surtout intéressées à l’histoire intellectuelle ou sociale. La Mongolie méridionale (actuelle Mongolie-Intérieure, l’une des cinq “ régions autonomes ” de Chine) possédait au début de ce siècle plus de mille temples et monastères de rite tibétain. Ce vaste ensemble, construit depuis la fin du XVIe siècle, s’inspire des traditions architecturales chinoises et tibétaines, mais présente un grand nombre de traits originaux. Bien qu’ayant subi d’importantes destructions au cours de ce siècle, il en subsiste une partie appréciable, qui mérite d’être étudiée tant pour sa valeur de patrimoine qu’en raison de son intérêt pour l’histoire de l’art et de l’architecture bouddhique en Extrême-Orient. Pour certains historiens d’art, chinois comme occidentaux, les constructions religieuses de Mongolie méridionale ne sont pas étudiées en tant que telles, mais en marge de l’architecture chinoise ou de l’architecture tibétaine. Elles apparaissent alors comme une forme abâtardie, voire mutilée, du “langage” architectural tibétain contaminé par les influences chinoises, ou, au contraire, comme une architecture chinoise amplifiant la surcharge décorative de la période mandchoue. Aujourd’hui pourtant, un intérêt croissant se dessine à l’égard des architectures mêlées de la période Qing (1644-1911) : les temples de Jéhol, les palais européens du Yuanming yuan dans la banlieue de Pékin, les églises et les mosquées. L’histoire des frontières et des influences réciproques entre la civilisation chinoise et ses voisins a fait l’objet d’un grand nombre de publications récentes qui nourrissent un débat, parfois houleux, sur la nature de la sinisation des peuples périphériques à l'empire du milieu. C’est dans ce courant que j’ai voulu étudier l’architecture bouddhique des Mongols méridionaux, de sa naissance (ou renaissance) à la fin du XVIe siècle, jusqu’au début du XXe siècle, car c’est précisément dans la réunion toujours renouvelée des influences variées, et non dans la pureté d’un hypothétique modèle ancien, qu’il convient de rechercher l’originalité, la valeur et la beauté de l’architecture mongole. J’ai également cherché à montrer que le terme de “style lamaïque international” employé par certains auteurs pour caractériser les solutions architecturales sino-tibétaines qui s’imposent en Mongolie, en Chine et au Tibet oriental sous le patronage des Qing, est impropre à qualifier cet ensemble extrêmement hétérogène et encore mal connu. Ce qualificatif “fourre-tout” ne fait que masquer la grande diversité de ces constructions et les particularités de leur histoire. Sources et méthodologie L’histoire de l’architecture mongole est encore peu connue, et notre première préoccupation a été d’établir des jalons chronologiques et géographiques à partir des monographies locales chinoises (difangzhi, fin du XIXe et début du XXe siècle) et des sources historiques Ming et Qing, ainsi que des études et des recensements réalisés par les Japonais sous le Mandchoukouo, qui domina la partie orientale de la Mongolie-Intérieure de 1931 à 1945. Ces sources ont, bien entendu, leur inconvénient : reflet d’une vision colonialiste de la Mongolie méridionale, elles sont parfois partiales, sélectives, s’appuient sur des données souvent légendaires et ne se préoccupent ni des cultes, ni de l’architecture. Les sources mongoles (chroniques de l’histoire du bouddhisme mongol et biographies de rois et de moines) apportent quelques informations complémentaires. Les récits des voyageurs européens, chinois et japonais du XIXe et du début du XXe siècle, les études ethnographiques chinoises et les observations faites par les missionnaires complètent ces sources, la variété des points de vue et des approches répondant au caractère foisonnant du sujet. Depuis les années 1980, une quantité importante de travaux de chercheurs mongols et chinois sur l’histoire du bouddhisme de Mongolie méridionale a été publiée, à une échelle qui reste cependant très locale, et le plus souvent avec une diffusion confidentielle. Les travaux monographiques ne tentent pas de synthèse ambitieuse, mais reconstituent des histoires locales inédites en exploitant des documents qui sont encore inaccessibles aux chercheurs occidentaux, comme des archives de monastères. La fréquentation de ces auteurs et la collecte patiente de ces matériaux est en partie responsable de l’ampleur que prit ce travail, et en constitue l’une des originalités. L’architecture religieuse des Mongols ne peut évidemment pas s’appréhender uniquement à partir de ces sources : l’étude sur le terrain d’un corpus représentatif des édifices religieux est primordiale. Pour définir ce corpus, j’ai d’abord tenté de dresser un inventaire détaillé des fondations en Mongolie méridionale, de les localiser et de récolter des informations sur leur état de conservation. Il m’apparut rapidement que l’ensemble du patrimoine bâti de Mongolie méridionale était considérable, dépassant le millier de monastères au tout début du siècle. De plus, dans l’ensemble, les destructions y ont été beaucoup moins radicales qu’en République de Mongolie, une cinquantaine de monastères ayant échappé aux fureurs de la révolution culturelle parce qu’ils avaient précédemment été reconvertis en bâtiments administratifs. Le retour à plus de tolérance ne marque cependant pas la fin des problèmes pour de nombreux bâtiments en voie de délabrement. J’aurais pu alors me contenter de traiter de quelques cas, les plus anciens ou les mieux conservés. Voulant cependant étudier la diversité comme constituant de l’architecture mongole, et sentant de plus l’urgence de rendre compte de l’ensemble d’un patrimoine méconnu et en grand besoin de protection, j’ai choisi de conserver une approche d’ensemble. Je souhaitais, par là, tenter de montrer qu’on ne peut honnêtement considérer un bâtiment “représentatif” et oublier le reste, ni dans une approche scientifique, ni dans une approche politique. Le prix résultant d’un tel choix, outre le sacrifice de nombreux détails, est la multiplication des noms de personnes, d’édifices religieux et de lieux. Les recherches que j’ai menées sur le terrain entre 1993 et 1998 m’ont conduite dans de nombreuses parties du monde mongol. Elles se sont heurtées à des obstacles multiples : les difficultés d’avoir accès à certaines sources, de localiser des temples dont l’existence est (prétendument) inconnue de personnes qui habitent à proximité, d’obtenir des autorisations de circuler dans ces régions fermées aux étrangers, la méfiance des autorités chinoises envers mon intérêt pour la religion des “minorités”, la rareté des moyens de transport, enfin, le manque de fiabilité des cartes de la Mongolie-Intérieure. Ces missions m’ont néanmoins permis de rassembler un certain nombre matériaux inédits : photographies, relevés, coupes, plans, informations orales et documentation écrite. Histoire et typologie des fondations Dans une première partie, j’exploite les sources historiques pour décrire la manière dont le corpus s’est progressivement bâti. Une attention particulière est portée aux origines, dominées par la question de la formation d’une architecture bouddhique chez un peuple de pasteurs dont l’habitat traditionnel est la yourte, adaptée au mode de vie nomade comme au climat. J’ai montré comment le passage de l’architecture mobile à la construction en dur s’est opéré progressivement : on peut imaginer aisément que la vie nomade s’accommodait mal, au début, de la sédentarisation d’une communauté monastique. Les temples et monastères itinérants (sous la yourte ou avec des structures de bois démontables) ont d'ailleurs subsisté dans quelques régions ; ils se font très rares à partir du XIXe siècle, et sont alors essentiellement des petits temples appartenant à des princes. Les tout premiers temples de Mongolie méridionale sont construits en dur, et, loin de surgir au milieu d’une steppe vierge de toute construction antérieure, prennent naissance dans un contexte déjà quasiment urbain. Ils sont édifiés dès les années 1572-1575 et leur architecture est une source d’inspiration pour les monastères de Mongolie septentrionale (rappelons que le monastère qalqa d’Erdeni juu, que l’on cite généralement comme le premier monastère édifié en Mongolie au XVIe siècle, date de 1585-1586). Le puissant chef des Tümed, Altan qan, alors à l’apogée de sa puissance, avait déjà fondé en 1572 une capitale, Köke-qota, dans la plaine riche et fertile située au nord du fleuve Jaune, à l’orée des steppes. Aujourd’hui capitale de la Région autonome de Mongolie-Intérieure, Köke-qota (actuel Hohhot, ch. Huhehaote) est ainsi la première ville fondée par les Mongols deux cents ans après l’effondrement de leur empire. Utilisant une main-d’œuvre alors disponible en abondance, celle des artisans chinois immigrés ou prisonniers des Mongols, Altan qan fait bâtir, quelques années plus tard, les premiers temples et monastères. Profitant d’une période de prospérité et de paix exceptionnelle, la ville devient un grand centre intellectuel et religieux. Ces premiers monastères, animés par la foi de grands maîtres religieux et de missionnaires, sont à l’origine d’un essor architectural sans précédent dans toute la Mongolie. Les édifices religieux de Köke-qota sont donc tout naturellement au cœur de cette étude, d’autant plus qu’ils sont particulièrement bien documentés et préservés. Avant même de conquérir la Chine en 1644, les Mandchous, conjuguant habileté politique et intérêt personnel authentique, patronnent l’Eglise mongole et tentent d’affaiblir le lien l’unissant au Tibet. Les fondations religieuses se multiplient dans toutes les principautés mongoles. L’Eglise amasse des richesses considérables et prend une importance prépondérante, tant spirituelle que temporelle. Les grands monastères deviennent des centres culturels, religieux, mais aussi politiques et économiques autour desquels se forment les premières agglomérations ; ils regroupaient, selon les régions, entre 30 et 65% de la population masculine, les plus grands complexes pouvant abriter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de moines. L’histoire des fondations bouddhiques est donc indissociablement liée aux aspects politiques, religieux, sociaux et économiques de l'histoire complexe de la Mongolie. Aussi le chapitre I-2 est-il consacré à une étude typologique des temples et monastères en fonction de leur nature, de leur origine, de leur fonction, de leur taille, ainsi qu’à leur fonctionnement interne, leurs activités spirituelles et temporelles et leurs relations avec les princes et avec la population. Les relations tibéto-mongoles et sino-mongoles (voyage de moines, de pèlerins, de spécialistes (géomanciens, charpentiers), voyage d’objets : maquettes, peintures, plans, carnets de croquis) sont évoquées afin de comprendre comment s’est opéré le transfert des techniques, des formes et des motifs architecturaux. Il faut pour cela chercher indices et allusions, car les mentions dans les sources sur le rôle et la nationalité des différents acteurs de la construction (commanditaire, maître d’oeuvre, géomancien, charpentier...) sont très rares. Une architecture éclectique La seconde partie, descriptive et arrangée selon un ordre géographique, vise à rendre compte de l’état actuel, ou du dernier état avant la destruction des monastères de notre corpus. Elle s’accompagne bien sûr d’illustrations et autres figures qui ont été rassemblées en annexe ; si nos propres photographies de relevés de terrain en forment la majorité, elles sont complétées par des documents publiés, parfois mal reproduits et non identifiés, mais qui constituent autant d’éléments de mémoire, précieux et irremplaçables. Les tableaux et inventaires, ainsi que les relevés de terrain (cartes, plan, coupes) et photographies sont donnés en annexe. Sont également étudiés les matériaux et les techniques de construction, les règles, prescriptions et modèles, les étapes du choix du site et de la fondation d’un monastère, ponctuées de nombreux rituels et prescriptions d’ordre symboliques et pratiques, le déroulement, enfin le coût des constructions. Cette description fournit les outils de notre troisième partie, l’analyse. Notre objectif y est de faire ressortir les caractéristiques principales de l’architecture mongole, et de déterminer les influences qui ont pu s’exercer tant sur les techniques de construction que sur les conceptions architecturales elles-mêmes. D’emblée, l’architecture bouddhique mongole témoigne d’un goût pour l’éclectisme, brassant des éléments architecturaux et plastiques tibétains et chinois. L’identification des variables-clé dans les plans au sol, les élévations, le mode de couverture, les techniques de construction et le décor permet d’établir une typologie architecturale de ces édifices en fonction des influences chinoises, tibétaines et locales, en particulier pour le temple central et pour les stûpas. Une telle analyse se heurte au problème des datations : les édifices religieux sont sans cesse restaurés, agrandis ou rebâtis à l’identique, dans le but d’acquérir des mérites ou de répondre à de nouveaux besoins. Les critères de datation classiques ne permettent pas d’en établir précisément la chronologie ; ils permettent cependant de confirmer ou d’infirmer les dates avancées par les sources. J’essaie donc de suivre, chaque fois que la documentation le permet, l’évolution historique, afin d’établir une caractérisation aussi nette que possible des édifices bouddhiques. Ma recherche s’inscrit dans le cadre plus général de l’étude des solutions permettant d’adapter une architecture locale aux besoins de la communauté bouddhique et des pratiques cultuelles. En retour, les préoccupations spirituelles du moment et certaines pratiques prééminentes se reflètent dans l’architecture. C’est pourquoi je m’intéresse plus particulièrement aux édifices mêlant des langages architecturaux différents, et présentant des caractéristiques originales par rapport à leurs modèles. Les princes mongols convertis se laissent imposer une monumentalité nouvelle. L’architecture qu'ils utilisent est importée de Chine ; sur celle-ci se greffe le langage culturel et religieux tibétain. Les modèles apportent avec eux leur logique, issue d'une longue histoire. Le développement historique du monastère reproduit des constantes que l’on retrouve dans l’ensemble du monde bouddhique. Les premiers édifices sont des sanctuaires, bien construits de manière à protéger les statues tout en les mettant en valeur, et les religieux officient sous la yourte. La salle d’assemblée, conçue pour les services quotidiens des moines, apparaît comme une construction moins urgente, et qui doit être extensible, fonction des variations de la taille de la communauté. La différence de construction entre les deux salles —le sanctuaire étant souvent de style chinois et la salle d’assemblée, d’inspiration tibétaine— se retrouve dans d’autres pays bouddhiques. La grande créativité qui s’est manifestée dans l’architecture de Mongolie méridionale s’est développée à partir des idéaux lointains —les temples de Lhasa, et même du nord-est de l’Inde— et des modèles plus accessibles —les monastères de l’Amdo, de Pékin, du Wutai shan. Les constructions mongoles ont pleinement pris la mesure de la diversité de leurs sources. Les édifices opérant une synthèse “sino-tibétaine” représentent, si l’on prend en compte les techniques de construction, le plan au sol et l’élévation, plus des deux tiers de notre corpus. Dans la grande variété des solutions architecturales adoptées dans ces bâtiments se dégagent des constantes, des règles non écrites permettant de maquiller une construction chinoise en une architecture adaptée à sa fonction, à son environnement et à la culture de ses commanditaires : toit chinois posé sur un toit en terrasse, murs en briques peints en blanc et non porteurs imitant les murs de pierre à fruit des bâtiments tibétains, caractéristiques tibétaines du plan au sol (salle d’assemblée carrée, plan centré), de la porte et du porche, ornementation extérieure chargée mêlant motifs religieux tibétains et motifs décoratifs chinois. Cette architecture est si composite qu’elle ne peut qu’être le fruit d’une lente maturation de traditions et d’influences diverses. Or la maîtrise technique et la souplesse d’interprétation des langages architecturaux chinois et tibétains sont remarquables dès la construction des premiers temples de Köke-qota. Leur éclosion, comparée à la longue histoire de l’architecture bouddhique chinoise et tibétaine, fut donc rapide. L’architecture bouddhique mongole n’est donc pas réductible à un modèle unique : elle porte en elle la triple marque du système culturel et religieux tibétain, de techniques de construction chinoises et d’une conscience individuelle authentique. Les éléments empruntés sont complètement assimilés en une synthèse harmonieuse ; il n’y a pas copie mécanique ni volonté de compromis, mais adaptation. La construction répond aux objectifs du culte, tout en s’adaptant aux conditions locales, et en mettant en valeur les parties importantes du bâtiment. Parce qu’elle utilise abondamment les ouvertures et les cours espacées, elle n’a pas le caractère fermé et la lourdeur de l’architecture tibétaine ; d’autre part elle rompt avec la conception unitaire de l’architecture chinoise. Elle suit un développement précis, évolutif, étroitement lié au fond historique, social, politique, économique et religieux, et aux échanges avec les mondes chinois et tibétain. Son étude rejoint l’analyse de la société mongole contemporaine et de ses symboles. Une telle maturité suggère l'importance du monastère, tant comme monument que comme institution dans l’histoire moderne de la Mongolie méridionale. Les monastères et les temples sont devenus, pour la noblesse mongole dont l’identité est menacée par une acculturation progressive, sa richesse culturelle, où le religieux, l’esthétique et le prestige s’entremêlent indissociablement. Leur exubérance contraste avec l’aridité du pays, la pauvreté relative des centres urbains et la monotonie architecturale des résidences princières. Les Mongols méridionaux n’ont, à l’heure actuelle, pas d’autre patrimoine architectural, si l’on excepte quelques palais. En un temps finalement assez bref, ils ont assimilé des formes et des motifs qui sont devenus partie intégrante de leur propre culture. De même que l’influence chinoise, très forte, par exemple, dans le vêtement, les motifs issus de l’art tibétain sont sans cesse repris pour orner les objets de la vie quotidienne. Il est donc possible de parler de styles architecturaux de Mongolie méridionale, essentiellement sino-tibétains, qui se caractérisent par leur éclectisme, leur ornementation et le jeu complexe des volumes. Les reconstructions récentes montrent à quel point ces formes et décors appartiennent aujourd’hui à la mémoire collective des Mongols méridionaux.
Temples et monastères de Mongolie-Intérieure pdf epub mobi 圖書目錄
點擊這裡下載
發表於2025-01-26
Temples et monastères de Mongolie-Intérieure 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
Temples et monastères de Mongolie-Intérieure 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
Temples et monastères de Mongolie-Intérieure 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
喜欢 Temples et monastères de Mongolie-Intérieure 電子書 的读者还喜欢
Temples et monastères de Mongolie-Intérieure pdf epub mobi 讀後感
圖書標籤: 藏傳佛教 濛古 清帝國 寺廟 喇嘛 *建築·曆史
Temples et monastères de Mongolie-Intérieure 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
Temples et monastères de Mongolie-Intérieure pdf epub mobi 用戶評價
Temples et monastères de Mongolie-Intérieure 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
分享鏈接


Temples et monastères de Mongolie-Intérieure 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
相關圖書
-
 京都仏像めぐり 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
京都仏像めぐり 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -
 一塵一刹一樓颱 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
一塵一刹一樓颱 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -
 靈隱寺 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
靈隱寺 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -
 颱灣廟宇圖鑑 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
颱灣廟宇圖鑑 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -
 劉敦楨全集(第九捲) 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
劉敦楨全集(第九捲) 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -
 窗捲-中國門窗 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
窗捲-中國門窗 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -
 中國門窗(門捲) 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
中國門窗(門捲) 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -
 Urban Regeneration in the UK 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
Urban Regeneration in the UK 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -
 Urban Design Futures 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
Urban Design Futures 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -
 Urban Regeneration and Social Sustainability 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
Urban Regeneration and Social Sustainability 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -
 Urban Regeneration in Europe 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
Urban Regeneration in Europe 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -
 一隅之耕 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
一隅之耕 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -
 西格拉姆大廈 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
西格拉姆大廈 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -
 阿恩海姆視知覺形式動力理論研究 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
阿恩海姆視知覺形式動力理論研究 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -
 建築企劃實務 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
建築企劃實務 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -
 Briefing Your Architect 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
Briefing Your Architect 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -
 後評估在中國 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
後評估在中國 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -
 The CRS Team and the Business of Architecture 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
The CRS Team and the Business of Architecture 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -
 美國名校建築水彩畫集 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
美國名校建築水彩畫集 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -
 建築與徒手畫 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
建築與徒手畫 2025 pdf epub mobi 電子書 下載